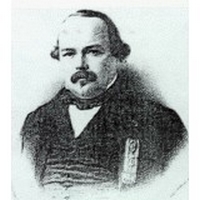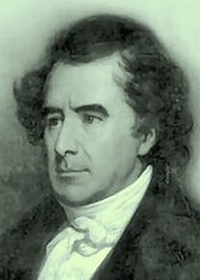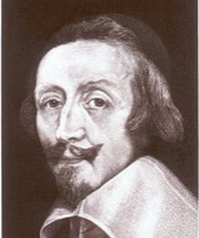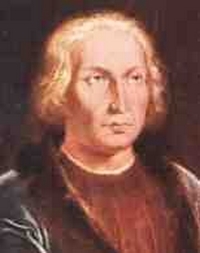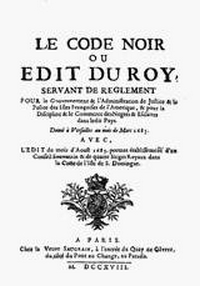La Martinique est l'un des quatre départements d'outre-mer, créés par la loi du 19
mars 1946. La loi du 2 mars 1982 érigeant la région en collectivité territoriale de
plein exercice a fait de la Martinique une des vingt-six régions françaises.
Distante de 6.858 km de la métropole, la Martinique est située dans l'archipel des
Petites Antilles (Lat: 61 W Long: 14 N, entre le Tropic du Cancer et l'Equateur). D'une
superficie de 1.128 km², c'est l'un des plus petits départements français.
Le relief de la Martinique est caractérisé par sa diversité :
- Il est constitué d'un massif montagneux au Nord, dominé par les pitons du Carbet
(1196m) et la Montagne Pelée (1397m). Cette dernière est un volcan toujours en
activité, qui figure parmi les volcans les plus surveillés au monde.
- Dans le reste de l'île, une succession de reliefs moyens, les mornes, peuvent
atteindre jusqu'à 505m d'altitude (Montagne du Vauclin).
- Une seule plaine se dégage de cet ensemble accidenté, celle du Lamentin,
au centre, où se trouve l'aéroport international, Aimé CESAIRE.
climat
Le climat, de type tropical, est chaud (26° de température moyenne annuelle) et
humide (hygrométrie de 80 % en mars-avril et 87% en octobre-novembre). La chaleur
due à l'ensoleillement est tempérée par l'influence océanique des alizés.
On distingue deux saisons :
- la première, le Carême, chaud et sec, s'étend de Décembre à Mai, avec une
période de grande sécheresse en février/avril ; l'ensoleillement est alors
maximal.
- la seconde, l'Hivernage, plus humide, dure de juin à novembre et se caractérise
par un risque cyclonique important.
Les régions montagneuses du nord connaissent un climat plus frais et plus pluvieux
que celui de la côte. En effet, les massifs montagneux élèvent un obstacle devant
l'alizé venu de l'océan Atlantique, provoquant des précipitations orographiques
abondantes. Il tombe par exemple en moyenne 10 mètres d'eau par an sur la Montagne
Pelée.
On compte en moyenne 2.800 heures de soleil par an en Martinique.
Histoire
La première date de l'histoire officielle de la Martinique est l'arrivée de
Christophe Colomb, en 1502, le jour de la Saint-Martin. Appelée Madinina,
«l'île aux fleurs» ou Jouanacaera, «l'île aux iguanes», la Martinique
devient française en 1635, et est gérée par la Compagnie des Isles d'Amérique,
créée par Richelieu.
Les fondements de la société d'habitation, une première fois sapés par
l'abolition de l'esclavage, proclamée le 22 mai 1848 après la révolte des
esclaves de la région de Saint-Pierre, vont être progressivement remis en
cause pendant le XXème siècle.
Celui-ci commence pour la Martinique avec le traumatisme de l'éruption de la
Montagne Pelée, le 8 mai 1902, qui annihile la ville de Saint-Pierre et 30.000
de ses habitants. La loi du 19 mars 1946 établit la Martinique comme département
d'outre-mer.
Histoire précolombiennede la Martinique
Le 15 juin 1502, quand Christophe Colomb débarque à la Martinique, plus précisément
sur le site de l'actuelle commune du Carbet, l'île est habitée depuis plusieurs
siècles. Les plus anciens vestiges archéologiques attestent en effet d'un
peuplement humain remontant au deuxième millénaire avant notre ère.
Les
mouvements de population dans l'espace caribéen ont en effet peuplé et dépeuplé
les îles au gré des flux et des reflux.
Venus du bassin de l'Orénoque (actuel Vénézuéla), les Arawaks se sont installés
en Martinique vers 100 avant J-C, dans le cadre d'un vaste mouvement qui a
concerné l'ensemble des îles de la Caraïbe, jusqu'aux Grandes Antilles.
Vers le
Xème siècle, l'arrivée des Caraïbes provoque un bouleversement dans l'ensemble
de la Caraïbe, au rythme de leur conquête progressive des îles de l'arc
antillais.
Leur arrivée en Martinique est datée vers 1350, ce qui explique que les premiers
Européens aient pu trouver chez les populations indigènes des traits des cultures
Arawaks (notamment chez les femmes, épargnées lors des combats et qui continuaient
à parler leur propre langue, distincte de celle des hommes).
La cohabitation entre les Français, arrivés en 1635, et les Caraïbes fut caractérisée
par des périodes d'entente et des conflits sanglants, qui aboutirent au départ des
Caraïbes à la fin du XVIIème siècle.
Leurs traces demeurent tant dans la toponymie
(communes de Case-Pilote et Rivière-Pilote, nommées en souvenir d'un chef Caraïbe)
que dans des noms vernaculaires de plantes (manioc) ou d'animaux (anoli, manicou)
entre autres.
De nombreux sites archéologiques précolombiens existent en Martinique,
essentiellement le long des côtes, où étaient installés les villages.
Le principal
site est celui de Vivé, entre Macouba et Basse-Pointe, sur la côte Nord-Atlantique.
La roche gravée (pétroglyphe) de la forêt de Montravail, dans la commune de
Sainte-Luce (Sud de la Martinique) compte également au nombre de ces traces.
La Martinique sous l'Ancien Régime
En 1635, est créée par Richelieu la nouvelle "Compagnie des Isles d'Amérique" ou
"Compagnie Saint-Christophe".
Un contrat est passé entre celle-ci et les Sieurs
Lienard de l'Olive et Duplessis d'Ossonville, qui s'engagent dès lors à occuper et à
gouverner pour son compte, les îles de la Caraïbe relevant de la couronne de France.
Le Normand Pierre Belain d'Esnambuc s'établit à la Martinique le 1er septembre
1635 avec une centaine de compagnons. Il débarque à l'embouchure de la rivière
Roxelane, sur le site de l'actuelle commune de Saint-Pierre, où est fondée la
ville du même nom, première capitale de l'île.
Le premier statut institutionnel de la Martinique est alors celui d'une terre
française administrée et exploitée par une compagnie à vocation commerciale.
Le développement de la culture de l'indigo, du café puis, au fur et à mesure de
la conquête de terres arables aux dépens des Caraïbes, de la canne à sucre,
s'accompagne de la mise en place d'un système économique basé sur l'esclavage.
La traite transatlantique, qui ne s'achèvera qu'au début du XIXème siècle,
amène en Martinique et dans toute la Caraïbe des centaines de milliers de
captifs originaires pour l'essentiel d'Afrique occidentale.
Le Code Noir
L'administration de la Martinique est assurée à partir de 1679 par un conseil
souverain dont 2 membres émanent directement de l'autorité du Roi : le
lieutenant général, et l'intendant. Les autres membres conseillers (le
gouverneur, le procureur général et le juge ordinaire) sont choisis par leurs
soins. Cette organisation durera jusqu'en 1685, année de promulgation du Code
Noir.
Le Code Noir, promulgué à l'initiative de Colbert, ministre des Finances de
Louis XIV, est destiné à réglementer l'esclavage dans la colonie en donnant un
statut spécial et légal au système sur lequel repose l'économie de la colonie.
Les esclaves sont définis comme des biens mobiliers, certains sévices sont
interdits tandis que d'autres sont institutionnalisés.
Sur le plan des
institutions locales, l'administration des colonies est marquée par la
suprématie de l'autorité militaire, qui, en raison de l'éloignement de la
France, concentre en son sein l'ensemble des pouvoirs.
Dès 1674, le Roi retrouve ses prérogatives et met en place un gouvernement
militaire unique pour les colonies de la Caraïbe, qui réside en Martinique.
Histoire de la Martinique au XIXème siècle
Alors que les influences révolutionnaires commencent à agiter la société
martiniquaise autour des questions du statut des personnes de couleur, du
maintien de l'esclavage ou de son abolition, l'occupation anglaise, qui dure de
1794 à 1802, marque pour la Martinique un retour pur et simple à l'Ancien
Régime.
Les choses se passent différemment à Saint-Domingue, où la Révolution Française
puis la tentative de rétablissement de l'esclavage par Napoléon, aboutit à
l'indépendance, en 1804, de la République d'Haïti.
En Guadeloupe, également occupée par les Anglais en 1794 mais libérée la même
année par Victor Hugues avec l'aide des hommes de couleur libres, l'abolition
de l'esclavage par la Convention, puis son rétablissement par Napoléon en 1802
provoquent une révolte menée par Delgrès (né en Martinique) et Ignace qui
choisissent, avec leur compagnons, de vivre libre ou mourir.
Rendue par l'Angleterre à la France, la Martinique ne connaît pas ces évolutions,
l'esclavage se perpétuant jusqu'en 1848.
Le 24 février 1848, la monarchie de Juillet
est renversée.
François Arago, ministre de la Marine et des colonies, admet la
nécessité d'une émancipation des Noirs, mais souhaite ajourner cette question
jusqu'au gouvernement définitif.
Sous l'intervention pressante de Victor Schoelcher,
sous-secrétaire d'Etat aux colonies, une série de décrets sont promulgués le 27
avril 1848.
Le premier abolit l'esclavage mais prévoit un délai de 2 mois à
compter de sa promulgation dans la colonie. Il prévoit en outre une indemnisation
des anciens propriétaires d'esclaves.
En Martinique, dans le même temps, le ton monte.
Des troubles éclatent sur les
habitations de l'île, les esclaves, ayant eu vent de ce qui se trame en métropole,
ne souhaitant pas attendre.
C'est la révolte, qui trouve son point culminant les
22 et 23 mai 1848 avec la lutte armée des esclaves de Saint-Pierre.
Sans tenir
compte du délai initialement prévu pour leur application -2 mois- les décrets
entrent immédiatement en vigueur.
La période du Second Empire (1852-1870) est
marquée par un retour au centralisme annihilant toute trace du pouvoir local,
sinon celui du conseil général aux pouvoirs élargis, mais entièrement soumis
à l'autorité du gouverneur.
Le retour des institutions républicaines, progressif entre 1870 et 1885, apporte
le bouleversement que constitue la mise en œuvre du suffrage universel. Les citoyens
choisissent librement leurs députés, leurs conseillers généraux et leurs
conseillers municipaux. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect.
La bourgeoisie de couleur occupe progressivement la représentation politique.
Le XXème Siècle et la départementalisation en Martinique
La loi du 27 juillet 1881 instaure la liberté de la presse et de l'imprimerie.
L'opinion publique se forme sur fond d'affrontements polémiques des organes de
presse qui se multiplient.
La vie associative prend son essor dans les sociétés
de pensée, les cercles littéraires, les partis politiques et le mouvement
yndical dès les années 1890.
Les années 1900 sont celles des premières grandes grèves, résultant de la
paupérisation du prolétariat agricole. La participation de 30 000 de jeunes
Antillais aux combats de la Première Guerre Mondiale (les deux tiers furent
tués, blessés ou faits prisonniers) renforce une revendication assimilationiste
qui s'exacerbe au cours du XXème siècle.
On peut citer parmi ses plus ardents porte-paroles, qui feront écho jusque dans
les allées du parlement français, Joseph Lagrosilière, Allègre, Henri Lemery.
En 1938, le conseil général de la Martinique se prononce à l'unanimité en faveur
d'une assimilation intégrale au statut départemental.
Cette revendication devra
attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour se réaliser.
Les leaders communistes d'après guerre, Aimé Césaire, Léopold Bissol, Georges
Gratiant, remportent des victoires électorales en Martinique.
Ils portent une
proposition de loi à l'Assemblée Nationale.
La question est débattue au Parlement
avec un rapporteur illustre, le jeune député-maire de Fort-de-France,
Aimé Césaire :
(En voir plus)
"Les propositions de lois qui vous sont soumises ont pour but de classer la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, et la Guyane française proprement dites en départements français. Avant même d'examiner le bien fondé de ce classement, vous ne pouvez manquer de saluer ce qu'il y a de touchant dans une telle revendication des vieilles colonies.
A l'heure où çà et là des doutes sont émis sur la solidarité de ce qu'il est convenu d'appeler l'empire, à l'heure où l'étranger se fait l'écho des rumeurs de dissidence, cette demande d'intégration constitue un hommage rendu à la France, et à son génie, et cet hommage dans l'actuelle conjoncture internationale prend une importance singulière (...).
On ne fait rien quand on a la géographie contre soi. Or en la circonstance, ce n'est pas seulement l'histoire que nous avons avec nous, c'est aussi la géographie. En effet, en affirmant le principe de l'unité française et de l'extension du régime de la loi à des territoires qui jusqu'ici ne relevaient que du régime des décrets, les propositions qui vous sont présentées n'empêchent pas de laisser éventuellement aux conseils généraux certains pouvoirs qui leurs seraient propres ".
J.O des débats de l'Assemblée Nationale Constituante n°23 du 13/03/46 et 25
du 15/03/46.
Ce débat parlementaire aboutit au vote de la loi de départementalisation du 19
mars 1946.
 La Martinique
La Trinité
La canne à sucre
Le Galion
Contact
La Martinique
La Trinité
La canne à sucre
Le Galion
Contact